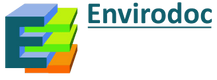Évaluation environnementale de site (ÉES Phase 1)
En gros c'est quoi ?
L'évaluation environnementale de site Phase 1 (ÉES Phase 1) existe depuis la fin des années 1980. Pour bien des gens, il s'agit de test de sol. C'est galvaudé comme bien d'autres choses. On fait des tests de sols pour les installations de traitement des eaux usées décentralisées, pour connaître la capacité portante d'un sol, pour en déterminer la capacité à supporter des plantes, des légumes. En ÉES Phase 1, il n'y a aucun test, analyse ou essais en laboratoire. La Phase I est faite sans échantillonnage, mais concerne plutôt une recherche documentaire, une visite de site et une interview. Dans les faits, il s'agit plus d'une opinion professionnelle que le résultat d'un test spécifique, car pour deux projets distincts sur un même site, il y aura toujours des différences dans les conclusions et recommandations. Deux professionnels peuvent même conclure avec des différences significatives surtout s'il s'agit de projets différents.
L'ÉES est l'objet de normes et d'exigences légales. Ce type d'étude qui est relativement jeune (30 ans environ) découle de situations très graves impliquant des cas qui ont été particulièrement suivis par les médias. On pense à Love Canal à Niagara dans l'état de New York, aux Lagunes de Mercier, au dépotoir Lasalle ou à la Lasalle Coke au Québec. Aujourd'hui l'évaluation environnementale de site Phase 1 est routine administrative dans le cadre de financement de projets immobiliers tant pour la construction que l'acquisition.
L'évaluation environnementale de site Phase 1 est réalisée afin de déterminer si une propriété immobilière est affectée par de la contamination ou est susceptible d’être contaminée. Avec l'usage, le gouvernement et le marché s'attendent aussi à ce que les évaluateurs identifient le risque de la présence de milieux humides ou d'espèces à statut précaire. Par contamination, on entend un nombre de choses allant de l'état des sols et l'eau souterraine principalement, mais aussi par rapport à la présence de déchets ou la présence de dangerosité dans un bâtiment par rapport à des substances désignées, l'infiltration de radon (un gaz radioactif naturel). On inclut même aujourd'hui des situations particulières comme l'humidité excessive et la présence de moisissures.
L'ÉES Phase I est une évaluation qui en mène large. Toutefois, il ne s'agit pas d'une inspection de bâtiment. Il s'agit d'évaluer si l'environnement constitue un problème, une créance, une situation problématique, une contrainte au développement. Elle doit être réalisée avec rigueur, perspicacité et pragmatisme. Il est important de faire « parler» le plus possible l'information disponible. C'est non seulement pour sauver des coûts, mais aussi pour éviter les mauvaises surprises. Les ÉES Phases 1 réalisées avec empressement ou de manière bâclée et reposant d'un jugement peu expérimenté sont trop souvent responsables de problèmes au moment de changements d'utilisation d'un site, de refinancement, de transfert immobilier, etc. L'ÉES - Phase I tient beaucoup de l'opinion professionnelle dont la valeur est intimement liée à l'expertise et l'expérience du ou des évaluateurs
Normes applicables CSA Z768-01 c2016 et CSA Z769-00 c2018
La norme appliquée au Canada pour encadrer la Phase I est la norme CSA Z768 (R2022). Elle est compatible à son équivalent américain ASTM E1527. Cette norme a été développée pour assurer qu'une évaluation environnementale de site Phase 1 constitue l'ensemble de toutes les investigations raisonnables nécessaires à établir si un terrain a été exposé à des risques de contamination. Il s'agit en fait de la réponse du marché aux développements législatifs américains suite à l'affaire Love Canal : le CERCLA. Le Canada, confronté à des problématiques similaires et l'intégration de son économie avec les États-Unis a développé un environnement normatif compatible via le Conseil Canadien des Ministres de l'Environnement (CCME). Pour en savoir plus sur le CERCLA; voir le bouton "en savoir plus" ici en bas.
L'ÉES Phase 1 fait donc partie des règles de l'art pour le gouvernement du Québec. Elle est identifiée dans le guide de caractérisation des terrains édition de 2024 qui a une portée légale. Envirodoc a participé au comité de révision de cette nouvelle édition. Au Québec, on fait l'évaluation environnementale de site Phase 1 en conformité avec la norme CSA-Z768-01 et ce guide de caractérisation selon les projets et s'ils sont assujettis. Tout projet assujetti au "Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement" doivent s'appuyer sur des études conformes au "guide de caractérisation" de 2024 que ce soit pour une demande d'autorisation ou une déclaration de conformité.
Une autre norme, la CSA-Z769 concerne l'évaluation environnementale de site Phase 2. Au Québec, toutes les phases d'étude incluant les travaux de réhabilitation relèvent des éléments normatifs du guide de caractérisation du MELCCFP. Notons par ailleurs les cahiers du guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales qui concernent des sujets spécifiques comme les sols, l'eau souterraine, les matières résiduelles dangereuses, etc. Au-delà des guides, il y a aussi les valeurs réglementaires, les critères du MELCCFP et les seuils qui constituent l'ensemble du cadre d'interprétation des résultats d'évaluation environnementale de site.
CCME
Le conseil canadien des ministres de l'Environnement est le principal forum intergouvernemental qui, sous la direction des ministres de l'environnement, mène une action concertée dans des dossiers environnementaux d'intérêt national et international.
C'est quoi un consultant professionnel en environnement ?
Au Québec, plusieurs professionnels offrent des services-conseils en environnement. Certains font partie d'Ordres professionnels pertinents comme les ingénieurs ou les géologues, d'autres sont agréés par l'AQVE. Toutefois, d'autres ne font partie d'aucun Ordre professionnel et ne sont pas agréés de l'AQVE. Le public qui fait affaire avec de supposés professionnels qui ne sont ni membres d'Ordre professionnel ou qui ne sont pas agréé par l'AQVE n'ont d'autre recours que le droit civil s'ils sont mal servis. Le domaine, si jeune, et la compréhension des enjeux tellement approximative qu'un client lésé a le plus difficile des recours contre un consultant en environnement à moins qu'il ne s'agisse d'un membre d'un Ordre professionnel ou un agréé de l'AQVE. En effet, un professionnel qui a tout à perdre risque de se comporter avec plus de professionnalisme et de désintéressement qu'un prétendu consultant qui n'a rien à perdre.
Chez Envirodoc, nous sommes préoccupés que le domaine de l'intervention sur les terrains contaminés ne soit pas un exercice réservé aux membres d'Ordre professionnel afin que le public soit protégé. L'expertise dans le domaine coûte très cher et il est très facile pour de petits joueurs de servir la clientèle moins aisée comme le particulier. C'est là que le bât blesse, car le particulier mal servi ne pourra probablement pas se reprendre. Pourtant, le conseil dans ce domaine correspond à l'ensemble des prérequis nécessaires à la création d'un ordre professionnel spécifique selon l'article 25 du Code des professions du Québec à savoir:
1° les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;
2° le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3° le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4° la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;
5° le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
Pour l'instant, la communauté de praticiens du domaine est distribuée dans divers ordres professionnels et associations et il n'existe aucune unanimité à propos de comment régir les activités professionnelles de cette communauté. En créant la liste des experts en 2003, le MELCCFP espérait mettre à niveau et normaliser la qualité des études, mais l'expérience est devenue impossible à gérer et la liste des Experts a été abandonnée en 2023. On note par ailleurs que le gouvernement s'intéresse surtout à 106 activités commerciales et industrielles qui ont tendance à laisser des terrains contaminés orphelins ou causer toutes sortes de problèmes. Les problèmes de contamination du particulier suscitent peu d'intérêt à moins que ceux-ci soient d'envergure et impactent des communautés entières. Une importante partie du marché de la consultation est laissé à lui-même avec plus ou moins de traction de la part des compagnies d'assurance et du monde financier. Il y a pire dans la vie. Les professionnels sont bien meilleurs aujourd'hui qu'hier. C'est en partie grâce à des outils fournis par le MELCCFP, des efforts de normalisation de la communauté de pratique et beaucoup plus de conscience des enjeux. Néanmoins, l'absence d'un ordre professionnel est non seulement une anomalie, c'est une aberration.
Les suites
La Phase 1 peut être suivie de Phase 2 et ensuite une Phase 3. Une fois qu'une Phase 1 est réalisée et qu’elle recommande de vérifier la qualité environnementale des sols ou des eaux souterraines, c’est que l'usage passé d'un site et les documents consultés indiquent qu'il a un risque de contamination qui vaut la peine d'être vérifié. Cela peut être un faible risque de contamination, mais impliquant quand même un gros risque financier. Cela parce que les volumes de sols qui seraient affectés seraient grands. D'un autre côté, parfois on appréhende que le terrain soit contaminé avec une quasi-certitude, mais cela impliquerait un petit volume. Le terrain serait contaminé quand même et ne pourrait être utilisé pour un projet de construction sans le décontaminer. Il faut donc le savoir. Parfois, le problème est complexe, la contamination ne va pas bien loin, mais elle s'est infiltrée sous un bâtiment. Décontaminer dans ce cas est plus complexe. Les Phases 2 et 3 servent donc à cela, vérifier et voir jusqu'où la contamination va lorsqu'il y en a et quels médiums sont affectés (sols ou eau souterraine et même les pores du sol dans la zone où l'air domine sur l'eau dans l'espace poreux).
Les travaux qui suivent la détermination du degré et de l'étendue de la contamination sont la réhabilitation environnementale ou la décontamination ou même la restauration (remise à l'état d'avant la contamination).
Une façon simple de concevoir l'approche utilisée en évaluation environnementale de site est la suivante:
Identification en évaluation environnementale de site Phase 1
Vérification en évaluation ou caractérisation environnementale de site Phase 2
Quantification en caractérisation ou évaluation environnementale de site Phase 3
Réhabilitation, décontamination de terrain contaminé en Phase 4
En somme, l'évaluation environnementale de site Phase 1 identifie ce qui mérite vérification. À peu près la moitié des Phases 1 ne recommandent pas de suite. Pour les autres, il faut vérifier. Les éléments qui se vérifient en Phase 2 sont par la suite évalués en rapport à leur importance; la quantification de volume, de masse ou de quantité ou d'intensité, la concentration, etc. Cette étape permet par la suite d'établir un plan de réhabilitation ou de décontamination si requis.
Le terrain est contaminé, qu'est-ce que cela veut dire
La contamination d'un terrain, ce n'est pas seulement un vice, c'est une créance, c'est une dette. Cela n'est pas toujours un empêchement d'utiliser le terrain, le développer ou le valoriser. On a qu'à penser au quartier Griffintown à Montréal où, malgré l'historique de 150 ans d'usage industriel, le développement et la mise en valeur pour l'usage résidentiel urbain n’en sont nullement ralentis tant les conditions économiques sont favorables.
Les sols, les eaux souterraines, l'air peuvent être contaminés par des activités humaines légitimes ou même présenter de la contamination naturelle. Les mines sont installées dans des dépôts tout à fait naturels, mais pourtant fort contaminés selon la perspective des normes ou des critères applicables à la qualité de l'environnement. C'est relatif, c'est le moins qu'on puisse dire.
Un site est pollué lorsque des critères ou valeurs réglementaires applicables sont excédés. La présence de matières à gestion restreinte est aussi une problématique à gérer. De plus en plus, les projets sont obligés de tenir compte de l'exposition des travailleurs à des contaminants. Des règles de plus en plus contraignantes sont applicables à la gestion des matières que l'on trouve sur les sites en développement autant dans les édifices que dans leur souterrain.
Pourquoi on est obligé de faire une ÉES Phase I ?
Vous n'êtes pas obligé, mais peut-être que ceux qui sont prêts à vous aider ne sont pas disposés à prendre des risques avec vous. Ce qui est exigé des institutions financières est de la simple diligence; faire ses devoirs. Il s'agit de connaître un peu mieux ce qu'on ne voit pas, découvrir ce qu'on ne sait pas. Personne n'a d’yeux rayons X. Quand on demande à quelqu'un de s'engager à garantir qu'il n'y a rien sous un terrain commercial développé depuis 1948, on s’aperçoit que la mémoire devient soudainement imprécise, les faits plus flous et les possibilités plus nébuleuses. Ça, c'est typique.
Certes, une évaluation environnementale de site Phase I est une dépense. Il y a plus de 10 000 sites contaminés au Québec dans le répertoire des terrains contaminés du MELCC et plusieurs estiment qu'il s'agit de 10% de la quantité réelle. Ce n'est pas anodin comme risque. Une ÉES - Phase I permet de réduire l'incertitude et la norme qui la sous-tend assure qu'elle est réalisée avec méthode selon les règles de l'art.
Celui qui demande la réalisation d'une Phase 1 n'est pas obligé, il est avisé.